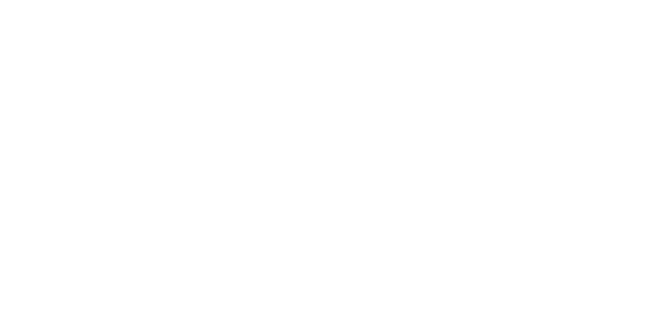Le 3 novembre 2020, à 14h37, j’ai l’impression de renaître. J’ai 45 ans. J’ai traversé l’épreuve du Covid, après avoir été plongé dans un coma artificiel, appareillé, pour respirer sans épuiser mon corps.
Ce jour-là je me représente comme le personnage et l’auteur d’un film d’anima-tion au ralenti, chaque geste que je fais, autonome, est un cadeau. Je sens la texture du « présent » : épaisse, légère, rugueuse. Je respire à nouveau, seul. Je parle avec ma bien-aimée. Je bois de l’eau. Revivre d’air pur, d’amour et d’eau fraiche : la joie d’une redécouverte !
Quelques jours plus tôt, j’ai été « réanimé », soigné par des femmes et des hommes, éprouvés, à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Je leur dis humblement merci*.
Aujourd’hui je suis animé d’un désir : ne pas en rester là. J’ai en vie de parler de cette épreuve : se raconter c’est se construire.
Quel « présent » inattendu pourrais je m’offrir ? Ré-animons le film : comment me suis-je accroché à la vie ? Comment suis-je revenu à la vie ?
La représentation commence, c’est la fin !
Mi-octobre, 5h du matin, je suis transféré depuis un autre hôpital en urgence, je débarque dans un service de réanimation. Je découvre, c’est une première. C’est inattendu : je suis attendu… par une foule, les danseurs d’un ballet. Ils virevoltent autour de moi : l’infirmier pique, le médecin m’explique, l’interne prend les constantes, les mots techniques fusent. Une ruche dans un cockpit d’avion. Derrière le médecin, des acolytes, internes, spécialistes, sont là, je remarque leur présence silencieuse.
Je suis couché, ils sont debout. Quel contraste !
Eux les soignants, nombreux, debout, en mouvement, précis, rapides, parlant, techniques, ordonnés ; moi seul, couché, immobile, flou, ralenti, réduit au silence, brouillon, grésillant. Plus je perçois le mouvement autour de moi, dans mon environnement, plus il se reflète en moi dans un affolement intérieur. Plus je perçois le contraste, plus je ressens la gravité du moment, physiquement… j’ai l’impression de sombrer : pantin inanimé et délaissé dans un dessin animé.
On me prend mes affaires personnelles, papiers, téléphone. Aucun moyen de communiquer avec mes proches. Sensible au lien, je m’éloigne et des autres et de moi. Parler m’est presque impossible. Je suis isolé au centre de la scène, comme dans un rêve fiévreux, à la fois là et pas là, ce qui semble à portée de main est inaccessible.
Je me sens assiégé. De bouger je suis incapable, interdit. Je suis à la merci : je me représente enfermé, prisonnier de moi-même.
Que se passe t il ? D’abord je perçois mes poumons qui se durcissent… comme de la pierre. Je suis en train de mourir, informé par une sensation, une sorte de pluie de gravier qui me gifle le thorax. Sensation d’asphyxie. Mon corps qui ne respire plus suffisamment seul, une douleur, une brulure, c’est rêche, du verre dans les poumons, un blocage, quelque chose se serre, ça ne passe pas, l’air ne passe plus, suffisamment.
Mon corps entier semble se figer, se concentrer sur le mouvement respiratoire, je manque d’air ! Il exerce sa liberté : le mouvement intérieur de respiration s’accentue lui aussi de plus en plus, pour de moins en moins d’air… je retrouve de l’air… insuffisant, je suffoque. Mon corps peut encore créer, un peu, trop peu, saccadé, ce mouvement intériorisé, pas du tout dans l’amplitude dont j’ai l’expérience, et pourtant c’est déjà, encore, de la liberté !
Au nom de mon désir de rester vivant, pour avoir toujours de l’air, je m’agite, je fais des signes avec les mains, les yeux…
Au niveau cognitif un tourbillon de questions, une foule de pensées, reflet du mouvement incessant de soignants, un ballet d’interprétations contradictoires m’assaille… j’ai peur de ne plus du tout respirer, je m’affole encore plus.
C’est tout mon « corps esprit » qui se mobilise à cet instant-là.
Ce que je fais pour continuer à vivre
Pour m’aider à respirer on me met un masque. Ok ! Non pas OK ! qu’est-ce que je dois faire ? faut-il inspirer par le nez ou par la bouche ? dans quel sens ça marche ? de quoi je parle : le masque, le processus émotionnel, la vie ? Quelle confusion ! Parler ? Je veux demander, impossible ! J’ai l’impression d’avoir le bec cloué. Parler n’est plus une option !
Dans mon désir de maîtrise, parmi mes habitudes mentales en situation de crise, il y a celle de m’adresser à moi-même comme à un autre, une forme de dissociation, entre « moi » (je me mets « entre guillemets » ?) et mon corps : « comment respirer avec ce truc ? Appliquons-nous. Expérimentons (vite ! s’il te plait) ; TU DOIS y arriver ! Allez Usha, souffle pour calmer « la bête », ne te laisse pas assaillir par les pensées noires, et n’oublie pas d’inspirer toi corps pour ne pas expirer ! »
Je veux m’appliquer, le médecin a été clair, rester conscient, j’entends vivant, dépend de ce masque, ou alors prochaine et dernière alternative : le coma artificiel ! Je me sens sous pression. Le temps presse. Le temps passe.
Moins ça marche, plus je pense… si mon corps ne peut rien mieux vaut que je pense, c’est toujours mieux que « rien ». Focalisé sur mes pensées, je perçois moins ce qui est présent, déjà, et me meut (m’émeut) corporellement. J’ai beau vouloir rester dans le pur esprit, mon corps fait son office et m’agit.
Pour répondre à son élan de vie une lutte s’instaure entre d’un côté le corps agissant qui préserve ce qui est et de l’autre le cognitif dans son désir d’avoir toujours plus de vie. Je voudrais bouger, dynamiser voire dynamiter ce qui est figé : le corps se fige, et la pensée bouge. C’est le match de ma vie.
Stratégie connue : plus je tente de maitriser mes mouvements de respiration, plus j’alimente ma peur de ne plus pouvoir respirer.
Je vois mes pensées tourner en rond et je vois mon corps agir autrement que ce que je veux. Plus je suis attentif à mes pensées, moins je le suis à mon corps. Plus je pense plus je me vois dissocié.
Nous avons tendance à imaginer que la volonté peut tout, mais face à la crise aiguë, à quoi ça sert d’avoir de la volonté quand le corps est déjà à la manœuvre ? Et pourtant, finalement, même dans cette situation, j’ai encore une liberté de choix : aller dans le « bon » sens (celui des aiguilles qu’on me montre ?), d’accompagner mon corps, dans une mobilisation synchronisée : laisser mes pensées « faire corps » !
Tant que mon corps lutte je continuer d’exister…
Accepter ou abandonner ?
Le masque n’a pas suffi, l’affolement n’a pas aidé. Le médecin m’informe : on devrait se préparer pour la respiration artificielle et le coma, sans tarder. Nous allons droit vers l’ultime alternative. Un instant l’angoisse m’assaille : et si je ne me réveillait pas ? Dans un élan vital, la conscience de la possibilité de mourir arrête tout net ma pensée.
A ce moment on m’enlève le masque quelques instants, en attendant l’anesthésie. Et je peux à grand peine dire quelques mots (les derniers ?) je me sens libre ! Dans mon désir d’être toujours en lien, j’ai l’habitude de communiquer, de mettre des mots sur ce qui m’arrive, et quand je ne peux pas, je vais tout de même me parler à moi-même, entendre ma propre voix… Effectivement, sentir les vibrations graves par vagues dans mon corps, ça me rassemble : esprit et corps liés par la voix.
Et voici que je me ressaisis, différemment, mobilisé entièrement pour accompagner ceux qui m’accompagnent, dans une unicité retrouvée, un soi (sans guillemets) et qui me dépasse : je me sens plus calme. A l’instant où je dis « oui allons y pour le coma », je prends la responsabilité de suivre ce que le corps (médical ?) me dit, j’adhère : je m’abandonne sans abandonner.
Tout de même : que va-t-on faire de moi endormi ? Entre sécurité et identité, comment garder ma liberté, mon autonomie ? A tout prix refuser d’être un objet. Si je ne suis pas un objet qui suis-je ? Un être vulnérable qui s’en remet aux autres, pas seulement en tant que malade mais en tant qu’humain prêt à se ressaisir lui-même à la moindre occasion !
Quand les soignants m’anesthésient, je suis en train, avec le peu d’air que j’ai de fredonner (je me demande ce que « donner à Freud » vient faire là), la vibration dans mon corps, particulièrement dans ma tête et mon thorax (tiens !) est le mouvement que je peux encore choisir librement pour m’accompagner et rester sujet.
A cet instant précis la panique et la volonté rendent les armes, simultanément. C’est finalement le coma qui aura raison de la bataille, le Général Volonté capitule et déserte dans les limbes, dans l’absence d’une conscience monolithique.
Tout mon corps dit OUI à ce qui aurait dû m’affoler encore davantage (dans une forme de logique raisonnante). La résonance, la vibration n’est pas la raison. Le corps sait que sa part esprit doit lui lâcher la bride pour mieux se ressaisir de lui-même en s’appuyant confiant sur ce qu’il fait déjà pour son auto-guérison.
Se réveiller davantage humain
Je m’endors… plusieurs jours…
Mon corps et mes poumons recouvrent partiellement leur capacité perdue.
Je plonge, je plonge, j’ai touché le fond.
Je peux dire « Merci coma, tu m’as permis d’arrêter la stratégie de lutte et l’anxiété qui va avec ». Et voici encore un cadeau : ce qui se présente et que je refuse est toujours malgré tout un « présent ».
Je me réveille, encore appareillé. Tel un nouveau-né, je reprends conscience, la douleur m’informe, d’une « petite » chose « évidente » que j’avais oublié presque toute ma vie : le souffle, c’est la vie ! Le prendre puis le rendre… le mécanisme de respirer, ça fait mal !
Je suis là et pas là. On me dira endormi, je suis pourtant conscient de ce qui se passe autour de moi, dans une hyper vigilance, attentif, au paroxysme de l’animation intérieure. Les pensées carburent sans arrêt. Quand je ferme les yeux je vois des images ou des reportages délirants, comme une obsession. Impossible de dormir plus de quelques instants. Ça dure cinq jours en s’estompant petit à petit. L’impression d’être encore plus dépendant qu’avant le coma. Je suis attaché, les poignets liés. J’ai été intubé. Je ne peux toujours pas parler. Je suis désorienté (suis-je en Espagne à construire des châteaux ?). Réveillé mais pas libéré ! Encore prisonnier ! Encore appareillé. Pas sorti de l’auberge ! J’ai l’impression de me noyer, d’être littéralement sous l’eau. Et dépendant de soignants qui doivent venir me changer la bouteille d’oxygène toutes les deux heures en me disant : soyez tranquille, on ne sait pas quand vous allez ressortir la tête de l’eau, un jour, d’ici là on revient… Et souvent deux heures plus tard, d’autres malades plus graves ont besoin de soin en priorité, compréhensible mais flippant quand on sent qu’on s’asphyxie ! Je n’ai pas la force pour de simples gestes. Je m’enfonce dans les abysses, dans la nuit, dépendant d’un masque à oxygène, dépendant de soignants.
Et chaque instant, davantage, je descends, je dépens, je m’abîme, et dans mon corps, et dans mes pensées.
Et ça y’est c’est reparti, je m’emballe, le moulin à pensées tourne à nouveau à plein régime, des images obsessionnelles, des hallucinations.
Bon sang de bonsoir, comment respirer efficacement avec cet attirail ? Le gouvernail semble m’échapper. Je me parle à nouveau : « Tu dois bien respirer. Pas trop tousser. Pas inspirer trop. Il faut… blablabla ».
Plus je me raconte que « ça ne va pas passer », que « ça va être difficile », plus je crois que je vais me noyer. Plus je me dis c’est sûr « ça va continuer à faire mal » plus j’entretiens la peur de m’asphyxier.
L’épreuve de la mort ? Non ! Les preuves de l’amour…
Entre la mort et la vie, je me cramponne à ce qui compte à cet instant : « moi ». Aucune morale. Et pourtant le souvenir des autres, aimés et amis, leurs messages, remplacent souvent les obsessions, les idées noires qui m’assaillent. Ces récits me donnent du répit, entre une impression de noyade, une asphyxie, et une toux à s’arracher les poumons (si seulement !) et à réveiller un mort (c’est peut-être l’idée ?), je « respire » intérieurement la joie : je souris aux moments d’humanité et de partage que j’espère et projette… une promenade en forêt ? un repas partagé ? un regard sans parole ! Et me voilà vibrant, à fredonner pour me calmer.
Dans le registre humanisant il y a aussi les gestes de certains soignants, qui dépassent la technique et le soin : un salut d’une main serrée (ce n’est rien ? c’est tant !), un appel vidéo à mon épouse ou un ami !
C’est là, à « l’épreuve de la mort » (ou de façon plus réaliste de l’idée de mourir), de la tentation d’abandonner, dans la solitude intérieure du « sombre vide », que j’ai fait l’épreuve de l’amour, entre la panique et la douleur : être aimé tel que je suis, sans devoir rien faire, sans pouvoir rien faire ? Être digne malgré tout et in fine de l’amour des autres ? Une vie à en douter, un instant pour le goûter… Tohu bohu. Quelle bénédiction !
Renaissance : Relevons nous !
Ce 3 novembre on m’enlève enfin l’appareil auxiliaire. Une appréhension, pourrais-je respirer sans ?
A cet instant je vis des sensations à la fois puissantes et libératrices, apparemment nouvelles, en réalité primitives.
Vivre d’air pur, d’amour et d’eau fraiche n’est pas une sinécure. Je comprends la valeur biologique, vitale du souffle.
Qu’est-ce que naître ? Respirer ? C’est d’abord laisser, pour la première fois, l’air entrer et gonfler les poumons. Ce déploiement intérieur est un étonnement pour le corps qui change de milieu et dépend pour la première fois de sa propre capacité de mouvement ! Ça s’apprend. Ça se perd. Ça se réapprend. Boire ? goûter à nouveau, c’est aussi mesurer la valeur de ce qui est présent et du cadeau que le monde nous fait, laisser entrer en soi, de sa matière, liquide, d’une température différente. Quel bonheur ! Parler ? créer du lien, jusque-là j’étais tout seul dans ma tête, à sombrer dans le conflit intérieur corps/pensée. Parler au sens du vrai dialogue, avec l’autre et le monde qui entrent eux aussi en moi, au sens où je produis un son extérieur qui reste moi et qui simultanément devient autre… et contribue au monde : ma parole.
Qu’est-ce que « re-naître » ? c’est prendre et rendre, de nouveau pour la première fois, dans un échange permanent avec le monde. Incorporer la matière du monde. Être c’est être davantage. Exister c’est être moins soi par ce mouvement de prendre du monde qui me transforme ; et simultanément davantage soi par le mouvement de donner de soi qui transforme le monde.
Enfin, j’ai mesuré à quel point marcher, pouvoir se mouvoir, dans le monde, aller de l’avant, dans la croissance de soi n’est possible qu’à la condition des gestes du quotidien : quelques jours alité, sans avoir la force qui permette de bouger, et les muscles fondent ! Impossible de marcher.
Vous qui ces temps-ci restez statiques chez vous, peut-être devant votre ordinateur, assis voire alités, vous pouvez aussi mesurer comment le corps, sa santé, sa capacité de bouger et partant l’esprit, vos pensées, dépendent des petits mouvements que vous faites sans conscience au quotidien. Levons-nous !
Qu’est-ce que je retire de cette expérience ?
J’ai traversé ce ou ces chocs traumatiques, j’ai été traversé par eux. Au lieu de m’y arrêter, je m’en suis fait cadeau. Mon corps a eu du mal à s’en remettre (trois mois environ) et en même temps j’ai vu à quel point l’expérience de l’épreuve était bénéfique.
J’ai vu combien mes habitudes mentales de pensées automatiques et comportementales de contrôle, m’ont conduit à exiger, parallèlement à ce que je vivais dans mon corps, de conserver coûte que coûte la maitrise et combien cette habitude alimentait mon anxiété. J’en ai fait l’expérience en direct live.
Comme en position méta par rapport à moi-même, je me vois penser, de deux manières :
- Penser, mouliner, chercher à contrôler… alimente chez moi l’anxiété, la peur de ne plus pouvoir respirer.
- Et simultanément quand je me vois penser, je vois comment le corps lui-même parle et se parle, encore, déjà. Cette stratégie cognitive est elle-même du vivant, de l’aspiration à exister !
Deux formes de « penser » qui me font voir mon monde intérieur comme dissocié : mon corps, mon monologue intérieur, et moi-même me regardant agir/penser ? C’est encore une représentation !
Revenons à ce que déjà je fais dans la situation. Face à la perception de la dureté dans mes poumons et de mon environnement (le ballet de soignants autour de moi, la distance avec mes proches), je me suis laissé croire que je ne pouvais plus respirer et encore moins communiquer, parler. Je me suis alors rigidifié, ma stratégie habituelle (parler à d’autres) était empêchée. Je me suis agité, l’anxiété a augmentée. Après un temps, et sans articuler, j’ai quand même pu : d’un côté, me parler (en pensée) et d’un autre, une fois le masque tombé, fredonner. Ce faisant, j’ai reproduit de façon désynchronisée l’effet habituel de ma parole sur moi dans l’espace du corps et du cognitif. Le calme est revenu. J’ai donné mon accord pour la guérison et l’auto-guérison.
Ainsi, j’apprends que je choisis de me faire vibrer : par ma propre voix, par l’émerveillement face à la beauté du monde qui m’entoure (les bons soins des soignants, le chant des oiseaux, l’eau, l’air pur), par l’espoir de partages à venir avec ceux que j’aime, par l’acte de penser/écrire/me parler de ce que je vis intérieurement.
Ces choix minuscules favorisent le rassemblement de ce qui est épars en moi en un corps esprit, conscient de lui-même, dans sa douleur, dans sa vitalité.
C’est freudonner pour moi qui me donne la force de faire la différance (avec un a comme écrivait Derrida), c’est à dire à la fois différer un instant la réponse à mon besoin (et par là faire preuve d’humanité) et aussi différencier ce que je vis (je suis ce que je serai, c’est-à-dire un corps y compris ses choix – ceux que j’aurais fait, en situation, face à l’adversité).
Et puis, j’apprends aussi que par rapport aux autres, mon environnement, c’est facile de partir. C’est plus difficile de revenir. J’ai fait l’expérience de ma sensibilité au lien et à l’amour de mon entourage. Réanimé, revenant dans le monde « normal », je me suis senti plusieurs semaines sur une autre planète, mes préoccupations tellement basiques (respirer à nouveau « l’air de rien ») contrastaient avec les préoccupations des autres qui me semblaient éloignées. L’anxiété de ne pas pouvoir respirer a duré quelques semaines après la sortie d’hôpital. Il s’agit de s’occuper de soi sans trop se préoccuper de soi, et si ça me préoccupe quand même, d’accepter que se préoccuper est une façon acceptable que le corps a de s’occuper de lui-même.
Et petit à petit, confiant que mon corps était en train de se guérir, mon nombril m’a ennuyé. Petit à petit seulement. J’ai senti que c’était le moment de partager cette expérience, en écrivant, encore une fois pour mieux me ressaisir, et aussi dans l’espoir peut-être d’aider ne serait-ce qu’une personne à sur-vivre (au sens de retrouver le bon sens) à une autre épreuve, la sienne.
En quoi la logique émotionnelle me sert dans cette épreuve et dans l’expérience qui s’en suit ?
La logique émotionnelle je ne sais pas exactement comment ça marche dans les tréfonds de mes automatismes biologiques, mais je sais que ça sert à quelque chose !
Par moments pendant l’épreuve, j’ai pu faire attention à la vie biologique qui m’animait, de voir au ralenti mes mouvements émotionnels, par séquences, pendant que j’étais dans l’expérience. Et ce même si je n’avais pas conscience de toutes les étapes de ce processus !
La pratique de la logique émotionnelle a permis, par bribes, que mon anxiété s’apaise, que mon attention se raccroche à quelque chose de vivant, corporel, au lieu de continuer à croire que je pouvais gérer ma panique, mon émotion.
En acceptant mon impuissance face à des réactions violentes et nouvelles de mon corps, je me suis donné un espace vide plein de puissance potentielle, un creuset d’espoir et de sens où mon corps esprit a pu davantage se consacrer à son processus d’auto-guérison.
Mettre en mots m’a aidé, pendant, et après le choc traumatique à sur-vivre, en me considérant davantage humain, parce que cherchant à parler vrai : c’est-à-dire parler de mon processus vital à l’œuvre.
Je me remercie d’avoir fait et de faire déjà tout ceci pour moi, aussi imparfait fut-ce. J’ai été réanimé aux deux sens du terme :
- mon corps s’est remis à fonctionner sans que j’en ai conscience.
- je me suis éveillé aux sens qu’avaient les processus biologiques qui me traversent, notamment la fonction de la pensée :
- toujours, vouloir, penser, alimentent ma peur ;
- et simultanément penser c’est aussi se panser, au sens de se guérir.
Comme disait Bernard Stiegler (inspiré par Derrida lui-même inspiré de Husserl) : « quand on pense avec un e on panse toujours avec un a, penser c’est toujours soigner, quand on pense on doit soigner », sinon ça n’a pas de sens.
Je suis responsable de ce que je panse (enfin on peut le penser…)
J’estime avoir eu de la chance de vivre cette épreuve et d’y sur-vivre au sens de pouvoir la dire. Telle est la valeur biologique du langage.
Et notre société, de quoi pourrait-t-elle avoir besoin quand l’asphyxie se présente ?
Tant que nous nous racontons que ça va être difficile, douloureux, mortel, ou que nous sommes dans l’incertitude, nous entretenons le stress, personnel et collectif, sans pour autant nous prémunir du risque, lequel ne dépend pas de nous. Tant que nous alimentons notre moulin à pensées, tant que nous anticipons, tant que nous focalisons sur le problème auquel notre corps a déjà répondu biologiquement (et continuera à répondre car c’est la fonction même de notre système nerveux) la peur grandit en nous.
Et si penser pouvait devenir panser ? Nous avons besoin de prendre la responsabilité de nous-même sans se laisser confiner dans un mode de pensée, cons damnés à penser sans résonner, à tourner en rond dans un monde soi-disant rationnel.
Parlons de ce que nous vivons, ré-animons nous, pansons le monde pour faire la différance !
Usha Matisson, le 26 février 2021
* Merci à toute l’équipe du service de neurologie du pavillon Montyon de l’Hopital Pitié Salpêtrière et particulièrement à Martine et Sylvain dont les gestes exceptionnels d’humanité ont contribué à mon rétablissement.
Merci à Catherine Aimelet-Perissol, Clothilde Marciano, Sylvie Alexandre-Rochette notamment pour les remarques et relectures.