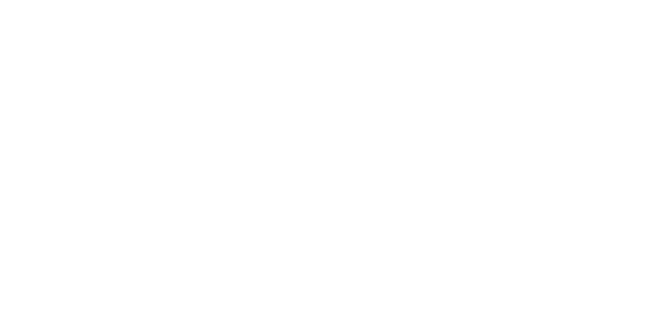Que dit la logique émotionnelle de l’alignement ?
Voilà que sonne l’heure de la rentrée, à la fois différente et toujours la même, avec son cortège de bonnes résolutions tissées par l’envie de faire autrement. Maison, travail, famille, amis, santé… tous les pans de la vie, ou presque, sont revus à l’aune des expériences et décisions estivales.
Comme une urgence à répondre enfin aux promesses oubliées, aux valeurs malmenées, aux signes négligés.
Dans le yoga que j’enseigne, cet impératif à suivre ce qui nous parait essentiel est illustré par le terme d’« alignement ». Et nous accompagnons volontiers le propos d’un geste de la main qui, partant du front, glisse en ligne droite jusqu’au sternum. Aligner mental et cœur, corps et esprit, terre et ciel.
Que dit la logique émotionnelle de l’alignement ?
Regardons le mot. « Aligner » vient du mot « lin ». Le terme s’est étendu de l’objet en lin au trait tracé. Sans précision de droiture. Pourtant, la première image mentale qui me vient est celle de quelque chose de droit, verticalement ou horizontalement. D’ailleurs, notre langage parle volontiers d’alignement des planètes (les unes derrière les autres), des chakras (les uns au-dessus des autres), des phrases (les unes après les autres) ou d’une politique (l’une en miroir de l’autre).
Mais cette représentation spatiale est-elle applicable au mot tel qu’il est utilisé dans le yoga ou dans toute pratique spirituelle ?
Cette idée d’un « tracé » implique-t-elle immobilité, inertie voire, puisque c’est aligné, que cela ne bouge plus ?
La LE nous rappelle que la force du vivant, c’est d’aller chercher un équilibre qui soit favorable à la vie.
« La nécessité d’être en équilibre est inscrite au plus profond de nos cellules » nous en dit Catherine Aimelet Perissol.
En effet, et sans que nous en ayons conscience, notre corps perd l’équilibre, cherche et le retrouve constamment puis tend à le conserver coûte que coûte. Ne serait-ce que physiquement pour, en bon bipède, tenir debout ce qui est l’aspiration naturelle du corps. Si nous prenons l’exemple de la marche nous voyons bien qu’il y a un mouvement qui nous fait passer d’un état de déséquilibre (sur un pied) à celui d’équilibre (revenir sur deux pieds).
L’un ne va pas sans l’autre : l’équilibre est un mouvement, une alternance dans le temps et non un état de stabilité fixe, tout comme la nuit ne va pas sans le jour ou le vide ne va pas sans le plein.
La pratique yogique ne saurait échapper à ce processus.
Lorsque nous cherchons à nous aligner c’est à partir d’une expérience éprouvée de perte d’alignement, d’une sensation corporelle ou d’un sentiment psychocorporel de désalignement. Nous pouvons nous sentir tiraillés, divisés ou encore oppressés : ces ressentis sont des signaux que le mental fait résonner au travers des mots et des pensées.
Mais à côté de tout ce que nous nous racontons « quelque chose se passe en moi et m’invite à retrouver l’alignement… ». Comme un fil que nous reprenons là où nous l’avons laissé avant que le flux (ou la somme ? ) de nos habitudes nous pilotent (en mode automatique). Ce fameux fil de « lin » dont est tiré le mot « alignement » et qui, lorsqu’il est tissé, dessine un entrelacs. Nous pouvons alors voir l’alignement telle une trame nous conviant à regarder ce qui se vit. Une boucle un peu lâche ou trop serrée perturbe l’équilibre, l’harmonie d’un canevas identifié comme essentiel et favorable à la vie.
Retrouver un alignement est un mouvement dont le but est de nous faire sentir l’équilibre de ce tissage, non pour le garder et y rester toujours mais pour connaitre le chemin qui nous y conduit.
Caroline Wietzel