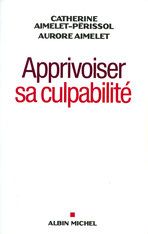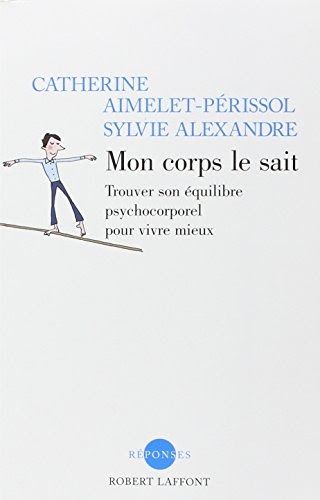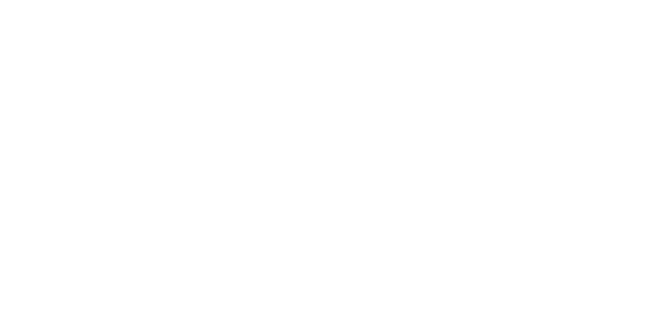« Votre cerveau n’a pas fini de vous étonner » de Patrice Van Eersel
par Pascale Fleury
VOTRE CERVEAU N’A PAS FINI DE VOUS ÉTONNER
de Patrice Van EERSEL
Fiche de lecture de Pascale FLEURY
PROMO 8
Notre cerveau est fabuleux : il est totalement élastique ! Même âgé, handicapé, partiellement amputé, le système nerveux central peut se reconstituer. Il est aussi totalement social, il donne sa pleine mesure en entrant en résonnance avec d’autres : nous sommes constitués pour entrer en empathie avec autrui. Ce livre va aborder ces questions passionnantes avec 5 médecins et chercheurs :
Boris CYRULNIK, neuropsychiatre et éthologue, Pierre BUSTANY, chercheur, spécialiste en imagerie médicale, Jean-Michel OUGHOURLIAN, psychiatre et professeur de psychologie, Christophe ANDRE, psychiatre, spécialiste des thérapies cognitives, et Thierry JANSEN, chirurgien devenu psychothérapeute.
PREMIÈRE PARTIE : NOTRE CERVEAU EST PLASTIQUE
Nos neurones se remodèlent et se reconnectent jusqu’à la fin de notre vie. Aujourd’hui presque n’importe quelle zone du cerveau est modelable, au prix d’efforts certes puissants mais accessibles. Ainsi, les zones corticales spécialisées dans une fonction sensorielle (toucher, vision, …) ou motrice peuvent se remplacer les unes les autres. Certaines personnes fonctionnent par exemple avec un demi-cerveau !
En peu de temps, sous l’influence d’émotions, d’images, de pensées, d’actions diverses peuvent se produire plusieurs phénomènes :
– de nouveaux neurones peuvent naître dans notre cerveau
– nos neurones peuvent se développer, multiplier leurs synapses ou se ratatiner
– nos réseaux de neurones peuvent même remplacer un sens par un autre
L’ensemble de notre cerveau peut entièrement se réorganiser suite à un accident par exemple. On peut garder un esprit élastique jusqu’à notre mort, si nous cultivons 2 aspects : notre gout pour la nouveauté et notre capacité à l’empathie.
Le concept de résilience dit que donner de l’affection à un enfant abandonné peut lui permettre de « renaître ». Au bout d’un an, placé dans une famille d’accueil affectueuse et attentive, ses synapses repoussent comme primevères au printemps, son néocortex est « regonflé », images à l’appui. Cette atrophie des orphelins mis en isolation sensorielle, comme leur résilience ultérieure, sont des preuves de la plasticité neuronale et corticale. Le plus important n’est pas que des neurones puissent repousser, mais qu’ils s’interconnectent. Un neurone isolé ne sert à rien. L’intelligence, la sensibilité, l’empathie, toutes les fonctions psychiques dépendent du degré d’interconnection et de vivacité des neurones.
Contrairement à ce que disent les Media, la plus grande maltraitance n’est pas physique mais liée à une carence affective. Celle-ci fait des ravages silencieux. L’enfant n’est pas mal traité, ni agressé. Il est juste seul.
DEUXIEME PARTIE : NOTRE CERVEAU EST SOCIAL
Nos neurones ont besoin d’autrui pour fonctionner car notre cerveau est neurosocial. Nos circuits neuronaux sont faits pour se mettre en phase avec ceux des autres. Nous n’avons donc pas le même cerveau, et donc pas la même vie, selon les relations que nous entretenons avec autrui. Nos neurones ont absolument besoin de la présence physique des autres et d’une mise en résonnance empathique avec eux. Les contacts virtuels, en augmentation croissante, poseront un gros problème.
Nos neurones attrapent les émotions des autres. Au moindre sourire, au moindre affrontement, nous sommes en résonnance. Ainsi, notre cerveau n’est pas le même selon que nous trouvons notre interlocuteur plus ou moins sympathique, drôle, suspect, stupide, dangereux, tonique… Les bienfaits d’une relation positive, de même que les méfaits d’une relation toxique, ont des effets cumulatifs.
Tout cela fonctionne, entre autres, grâce aux neurones miroirs. C’est un mécanisme qui fait que dès la naissance, notre cerveau « mime » les actions qu’il voit accomplir par d’autres, comme si c’était lui qui agissait. En 1996, en Italie, RIZZOLATTI travaille avec des singes, portant des casques à résonnance magnétique. Pause déjeuner, il tend la main droite vers un sandwich : le cerveau du singe qui le regarde fait crépiter le casque. Le chercheur arrête son geste, puis le recommence ; à nouveau crépitement. L’IRM lui montre que le singe, resté immobile, envoie de l’énergie à son cerveau « comme si c’était lui qui levait la main droite pour attraper le sandwich ! Il venait de découvrir le principe des neurones miroirs ! Mais pour cela, il faut que l’objet soit signifiant pour le singe. Une banane, crépitement. Un stylo, rien.
L’intelligence relationnelle repose sur un processus fulgurant de rapidité. Notre cerveau peut capter, en quelques millièmes de secondes, quantité d’informations simultanées (odeur, aspect amical ou menaçant…) sur la personne en face de nous. Notre mécanisme de survie, processus archaïque, se déroule hors de toute conscience, à la vitesse éclair d’un réflexe. Si le rire est le processus de contagion neuronale le plus rapide de tous, le sourire est l’expression que le cerveau humain décrypte le plus vite et avec le plus de nuances. Sans cette rapidité et cette subtilité de décodage de l’autre, l’empathie serait impossible. Cette communication ultrarapide et multiniveaux constitue « la voie basse » de l’intelligence relationnelle. Elle ne fait pas de compromis, ni de diplomatie. D’où l’importance de notre cerveau civilisé ou « voie haute » qui commence par la réflexion consciente et met en action les structures neuronales du néocortex. Cette voie est plus lente, mais plus nuancée, riche, flexible, faisant intervenir la mémoire, les valeurs, les croyances, la culture (ex : au cinéma, la voie basse réagit comme si le film d’horreur était vrai, et la voie haute nous contrôle pour que nous restions assis sans nous sauver).
On a montré que les relations harmonieuses mettent tous les chronomètres neuronaux des protagonistes en phase, ce qui, outre un meilleur métabolisme, leur apporte un bien-être accru. L’altruisme serait un instinct. Comme nous ressentons la souffrance de l’autre, en le secourant, nous cherchons à nous soulager nous-mêmes. Dans notre cerveau, les neurones qui ressentent l’autre côtoient les neurones moteurs qui permettent d’agir. Or, notre altruisme est sans arrêt bloqué. Nous sommes bombardés d’informations terribles par les media, sans capacité d’action réelle (que ne sont pas chèque ou signature de pétition), ensuite, nos grandes villes ne nous permettent pas de répondre au trop plein de contacts, enfin nos relations amicales ou familiales se passent le plus souvent par l’intermédiaire de machines qui n’autorisent pas le contact direct, physique, sensoriel. Les enfants jouent de moins en moins entre eux et sont de plus en plus violents… L’indifférence nous gagne tous.
A quoi servent les neurones miroirs ? A nous préparer à l’action, en renforçant les voies neuronales de notre cerveau moteur. Plus vous répétez l’activation d’une voie, même par imagination, plus cette voie se renforce, plus le geste auquel elle correspond va devenir facile, automatique. Ainsi, vous entrainez vos doigts à bouger, au bout de 8 jours, vous les bougerez 50% plus vite. Si vous avez seulement visualisé l’action, votre vitesse d’exécution s’améliorera de 20 à 30 %, tout cela grâce au système miroir. Avec la neuro imagerie, on constate que si un musicien en écoute un autre jouer, il se passe dans leurs cerveaux des choses absolument comparables. Dans le cerveau d’un non musicien, même s’il apprécie le concert, il ne se passe pas grand choses dans son cerveau. Ceci est vrai pour tous les arts, les apprentissages. Notre esprit ressent le besoin impérieux d’achever une forme ou un geste à peine ébauché. Il est bâti pour systématiser, intégrer et rationaliser, parfois à outrance.
Ce système miroir nous pousse à faire le bien d’autrui, car nous y avons intérêt. Tout être vivant cherche à survivre, étendre son territoire et à se reproduire. Nous avons développé notre instinct de groupe car seuls nous aurions été impuissants. Nous avons intérêt à aider nos congénères, et quand autrui éprouve une souffrance, en nous résonnent les mêmes sensations désagréables. On recherche donc le bonheur d’autrui… pour notre propre satisfaction. Mais, quand le corps social se dérègle, ce système tombe en panne. Pour ne pas souffrir de voir autrui souffrir, je le fais disparaître du champ public : camps, ghettos, asile, prisons… Pour bien fonctionner, le système miroir doit être encadré par des valeurs, une culture, des savoirs. Notre plasticité neuronale a donc vraiment un rôle social.
Les mécanismes hormonaux et enzymatiques influencent la neuroplasticité, ou la bloquent chez les dépressifs et les stressés. Un cerveau déprimé ne donne pas les mêmes images qu’un cerveau tonique. Pourquoi certaines personnes ne dépriment jamais, bien qu’ayant subi guerres ou traumatismes, alors que d’autres, pour des riens, se mettent à broyer du noir et sont incapables de réagir ? L’exercice physique assidu semble empêcher la dépression par la sécrétion d’insuline, un des facteurs de développement des réseaux neuronaux. L’exercice physique retarde le vieillissement, et dans une moindre mesure l’alimentation… Mens sana in corpore sano !
La plasticité neuronale baisse avec l’âge, mais si un vieux cerveau est bien entraîné, il connaît des raccourcis neuronaux et fonctionne à merveille, voire mieux que chez un plus jeune. Si un enfant ne peut utiliser son intelligence et ses facultés mentales (guerre, abandon…) ses réseaux synaptiques ne se développeront pas, et on pourra conclure qu’il est stupide. Le cerveau ne s’use que si l’on ne s’en sert pas !
La découverte des neurones miroirs suscite un enthousiasme énorme dans toutes les disciplines de la neuroscience à la psychiatrie ou la philosophie. Le PET-scan enregistre dans votre cerveau que, si vous me voyez remplir un verre d’eau et le boire, les mêmes zones s’allumeront que dans le mien. Alors que si un bras de levier mécanique fait le même geste, votre cerveau n’aurait pas bougé. Votre cerveau agit en miroir parce que je suis un être humain et vous aussi ! Cela explique aussi l’empathie. Cette disposition du cerveau à imiter ce qu’il voit faire -quand l’action l’intéresse- explique l’apprentissage, mais aussi la rivalité.
Après le cerveau cognitif et le cerveau émotionnel, nous aurions donc aussi un cerveau mimétique. Nos neurones miroirs détermineraient toutes nos relations. Si nous désamorçons la spirale violente qui transforme le modèle en rival ou obstacle, je pacifie mes rapports humains. Cela va susciter des émotions et sentiments positifs, bonne humeur, estime, amour. Mais si le rapport mimétique, entre 2 individus tourne à la rivalité, tout l’appareil cognitif et intellectuel va se mobiliser pour renforcer ma rivalité et donc mon agressivité. Cette hypothèse reprend les 3 états décrits par Henri LABORIT : l’agression, la fuite ou l’inhibition et remet en question toute la psychopathologie. On ne cherchera plus à réduire les symptômes de la maladie mentale au niveau cognitif par la rationalité, au niveau émotionnel par la psychothérapie, mais en trouvant un moyen d’agir au niveau mimétique. La sagesse consiste à apprendre à désirer ce que l’on a.
TROISIÈME PARTIE : NOTRE CERVEAU EST ÉMOTIONNEL ET AUTONOME
Sentir, penser, agir… Tout cela ne consomme que 1 % de notre énergie cérébrale, c’est la partie consciente. Le reste est utilisé par le non-conscient. Un neurone ne devient opérationnel que si des dendrites se mettent à pousser, le reliant par des synapses à d’autres neurones. Les 6 moteurs de croissance dendritique les plus importants sont : le désir, l’affection, l’interrogation, la réflexion, l’action, l’effort volontaire. Ce qui détruit les neurones, là aussi, dans le désordre : le vieillissement, le stress, la pollution, certaines maladies, et surtout la passivité. Apprendre, aimer, agir méditer rend vigoureux nos neurones et nos synapses.
On sait maintenant que notre cerveau ne comporte pas de régions spécialisées dans le calcul, la sémantique, la vision : tout fonctionne en réseau ! Et ces réseaux échangent en permanence des informations, même quand on pense ne rien faire. Ces réseaux sont à la fois stables (sinon on ne saurait plus qui on est en se réveillant) et mouvants (se rappeler un souvenir, c’est aussitôt en modifier le réseau).
Notre cerveau fonctionne toujours à flux tendu, est toujours à 100% de ses capacités, nuit et jour. Mais seulement 1 % de cette activité est cognitive, c’est-à-dire accessible à la conscience, ce qui nous sert à penser, parler, inventer, décider ou bouger. Les 99 % constituent « le fonctionnement cortical par défaut ».
Les 3 principaux créateurs de réseaux neuronaux sont l’imitation, l’émotion et la répétition. Ces 3 facteurs constituent la trame de notre vie affective et relationnelle, car notre cerveau est éminemment social. Le bonheur s’engramme, l’avantage des émotions, c’est qu’on peut apprendre à les canaliser, les apprivoiser nous dit Christophe ANDRE. Les émotions se trouvent au centre de la plasticité neuronale. Nos réseaux neuronaux sont génétiquement bâtis pour nous faire ressentie la peur, la colère, la joie et la tristesse. Ces dispositions sont ensuite modulées par les différences individuelles, familiales, sociales, culturelles etc… Nous avons grand mal à réguler nos flux émotionnels, nous basculons en « pilote automatique » dès qu’ils deviennent trop intenses, sans les contrôler.
La base de tout changement psychique émotionnel durable et autoproduit c’est la neuroplasticité : la survenue de modifications fonctionnelles des voies neuronales. Et la base de la neuroplasticité, c’est la notion d’expériences et d’exercices inlassablement répétés : l’entraînement de l’esprit. C’est vrai pour la thérapie, mais aussi pour la prévention.
L’apprentissage de la pleine conscience traite la phobie du rougissement : la personne rougissant se focalise à 100% sur 2 questions « est-ce que je rougis ou non ? » et « est-ce que les autres ont vu que je suis si mal à l’aise que je deviens plus rouge qu’une tomate ? ». Plus on focalise sur cela, plus on rougit : c’est un cercle vicieux ! On place le patient face à un public qui le regarde en silence. Il devient vite écarlate, et doit élargir son focus attentionnel. Le psy lui dit, « vous êtes rouge, c’est désagréable, c’est comme cela. Prenez conscience des petits bruits, comment vous respirez, la lumière et la décoration de cette pièce, les vêtements et les gestes des gens… Tout cela sans fuir les émotions désagréables ressenties, mais en invitant d’autres éléments à votre conscience ». Ainsi, le flot émotionnel est toujours là, mais peu à peu il va s’écouler de manière différente. En pratiquant régulièrement, la personne va réussir à guérir de façon rapide et spectaculaire.
La psychologie contemporaine s’intéresse aux grandes émotions, franches et entières, et se préoccupe peu des états d’âme. Les grandes émotions nous possèdent totalement, mais ne durent pas. Des état d’âme, eux, émotions plus subtiles, sont tenaces et influentes et peuvent durer des jours, des semaines ! Christophe ANDRE considère qu’elles sont incroyablement importantes, et que l’essentiel de notre vie intime est fait d’un tissage d’états d’âme.
QUATRIEME PARTIE : NOTRE CERVEAU RESTE UNE ENIGME
De quoi sont faits nos rêves ? Les neurologues croient aujourd’hui que, pendant le sommeil paradoxal, le cerveau, libéré du contrôle conscient exercé par les lobes frontaux du néocortex, remodèle les réseaux neuronaux. A quoi ressemble ce remodelage ? Mystère ! Tout ce à quoi vous avez accès, c’est la traduction qu’en a fait votre moi conscient à la dernière seconde, juste au moment éclair du réveil, à la sortie de votre rêve.
Jean-Pol TASSIN, neurobiologiste est spécialiste des addictions. Les substances (cocaïne, morphine, cannabis, héroïne, amphétamines, alcool, tabac) envoient dans nos neurones, via le système sanguin, des molécules qui s’immiscent dans le fonctionnement des synapses. Ces nano-espaces entre les cellules nerveuses abritent les allers-retours ultrasophistiqués de la bonne centaine de neuromédiateurs existants (adrénaline, sérotonine, acétylcholine, dopamine..) qui modèlent nos états intérieurs, pulsion, émotions, décisions, inhibitions, sentiments et états d’âme. L’effet de ces drogues est toujours le même : libérer de la dopamine, qui vient stimuler artificiellement le « circuit de la récompense » dans le cerveau, ce qui nous procure la sensation de plaisir.
TASSIN considère 2 réseaux neuronaux : celui de base, soit 99 % des neurones, qui traite toutes les opérations de la vie (sens, motricité, décisions, volonté, mémorisation… Le second compte moins de 1 % des neurones, superposé au premier, dans un rôle de modulateur, rôle capital ! En effet, selon les circonstances, ce réseau modulateur peut décider d’affecter telle tâche corticale au cerveau cognitif lent (on en aura donc conscience, on pourra en parler, le mémoriser…) ou bien la tâche sera confiée à des instances inconscientes, en analogie rapide. Par exemple, on peut respirer sans y penser, en analogie rapide ; on peut aussi le faire de façon volontaire ce qui entre alors dans le champ de notre cerveau cognitif lent.
Lorsque nous nous endormons, le système modulateur de nos neurones noradrénalinergiques et sérotoninergiques cesse de fonctionner (sinon, c’est l’insomnie garantie) et le cerveau cognitif lent est hors circuit ; toutes les informations sont traitées de façon analogique rapide. C’est le sommeil paradoxal. TASSIN affirme que ce n’est pas le temps du rêve, car celui-ci ne surviendrait qu’au moment du réveil. On se réveille car nos neurones modulateurs se sont mis à fonctionner, même une fraction de seconde. Notre cerveau cognitif lent se réveille, même brièvement, et en une fraction de seconde, fabrique une histoire… (une image par 5 centièmes de seconde). Notre sommeil est constellé de miro-réveils neuronaux de survie. Bref, c’est toujours l’énigme …. Si le scénario de nos rêves s’écrit à la seconde où nous nous réveillons, que se passe-t-il lors du sommeil paradoxal ?
L’apprentissage n’est possible que grâce à la plasticité neuronale. Nos connexions dendritiques ne cessent de fabriquer de nouvelles synapses et d’en dissoudre d’autres. Quand on apprend qq chose de neuf, certains circuits se créent, d’autres non réactivés dépérissent. Toutefois, certaines voies neuronales installées ne s’effacent plus : quand on a appris à monter à vélo, c’est pour la vie. Quand on observe les cerveaux de personnes ordinaires et de moines ou grands méditants devant des situations à fort contenu émotionnel négatif, tout le système neuro-immuno-endocrinien des personnes ordinaires se trouve ébranlé avec une forte réaction de stress, suite à une forte activation de leur néocortex droit. Cette réaction est faible chez les nonnes par exemple.
Ensuite, les 2 groupes étudiés rassemblaient des méditants de plus de 10.000 h et de plus de 40.000 h, histoire de ne pas supposer un biais génétique (ceux qui ont choisi la voie de la prière ou de la méditation étaient peut-être prédisposés à cette vie). La seconde catégorie était peu stressée par les situations fortement négatives, et retrouvaient plus vite un etat d’émotions agréables, avec un néocortex gauche fortement activé, et une meilleure défense immunitaire. Nous pouvons donc inverser les effets dévastateurs d’un contexte émotionnellement négatif par la méditation
De nos jours il existe un débat stérile entre les 3 grandes voies de la psychologie : la psychanalyse, le comportementalisme et la psychologie humaniste, au lieu de les considérer comme complémentaires.