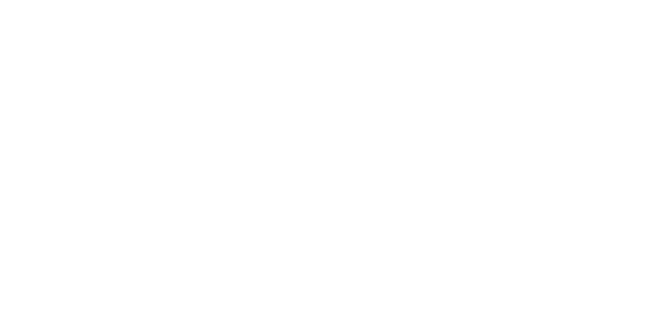Bon, si je voulais vérifier que, quoiqu’il se passe dans l’environnement, nous sommes mus et émus par un incontournable désir d’existence, ces vacances et cette rentrée en furent l’occasion !
Drôles de vacances ! Partir ? Pas partir ? Je vais préparer les masques, le gel hydroalcoolique, éviter les plages, et donc aller en Montagne, le grand air, j’y serai tranquille et en sécurité, c’est calme la montagne l’été ! Mais cette année, c’est l’affluence record : nous sommes nombreux à avoir eu la même idée. Tiens, cela me rappelle ce que nous dit René Girard du désir : « Nos désirs ne deviennent vraiment convaincants que quand ils sont reflétés par ceux des autres. »
Une amie me prévient : tous masqués dans le village depuis hier, et il y a plein de monde. Effectivement, la rue principale est bondée, des gens me frôlent et je me surprends à penser « il ne peut pas garder ses distances celui-là ? ». Mon désir de Sécurité, versus sûreté, se manifeste de cette façon au détriment apparemment de mon désir d’avoir du lien social. Et puis je m’habituerai au fil des jours…. L’habitude, même limitante, répond aussi à une force de vie ! Ne dit-on pas la force de l’habitude ?
Tiraillée entre mon désir de sûreté et de lien (me référer aux habitudes qui me rassurent, vivre en tribu) et mon désir de liberté (profiter de l’été, vagabonder, découvrir des gens et des lieux nouveaux), je suis inquiète, puis euphorique, puis inquiète selon les informations que j’écoute et les pensées qui m’assaillent. Et donc toute tourneboulée, comme une girouette prise dans le vent fort de la médiatisation du COVID, ou comme un lapin prit dans des phares d’une voiture, tétanisée derrière mon masque.
Selon une lecture psychique de la situation, j’aurais trois possibilités pour répondre à ce trouble et recouvrer la paix. :
- Fuir ! Mais où ? Le virus se balade sur toute la planète et les informations d’ailleurs ressemblent aux nôtres.
- Combattre ! Mais quoi, et qui ? Les donneurs d’informations ? Le virus ?
- Me replier ! Mais comment ? Rester chez moi, est-ce que c’est possible sans déprimer ? Est-ce que ce n’est pas mourir à petit feu pour nous, occidentaux, si habitués à une vie trépidante ?
Autre piste : méditer ! J’ai remarqué que je me calmais parfois en pratiquant, mais m’énervais d’autres fois ! Il s’agit de me poser sur une chaise pour tenter la tranquillité, de fermer les yeux, d’écouter les sons, de prendre appui sur ma posture, de porter attention à mon souffle, de laisser mes pensées venir et s’en aller sans m’y attacher. Et pourtant je sais, grâce aux philosophes, que mes pensées ne sont pas moi, que tout est impermanent et en permanente transformation ! Mais certains jours, quand je rencontre mon trouble, mon affolement, ma peine, je n’ai plus qu’une idée en tête, arrêter ! Arrêter cette pratique ! Et vite aller marcher, partir en randonnée ou rejoindre des amis pour un apéro ! Toujours mon désir de sécurité, mais cette fois versus liberté. Le savoir philosophique est alors bien loin ! Me voilà pressée d’échapper au malaise éprouvé…
Bon, face à ce chaos tiraillement intérieur entre deux polarités, que me dit la Logique Emotionnelle ?
Le rapport au réel est la grande affaire de chacun !
Dans « Le réel et son double » Clément Rosset écrit : Quoi qu’on fasse, quoi qu’on pense, quoi qu’on interprète, il n’y a qu’un réel, et il finit toujours par s’imposer. Et en général, cela fait choc, et donc, parfois, ce rapport fait mal ». Les neuroscientifiques valident.
L’émotion dans son processus somatique puis psychique, nous donne justement à voir ce rapport : comment mon corps, autrement dit ma réalité biologique, rencontre-t-il, via mes perceptions et mes sensations, ce réel ? Comment s’adapte-t-il dans l’instant de la rencontre pour que soit satisfait le besoin d’exister ? Ensuite comment mes comportements cherchent à garantir dans le temps cette satisfaction ? Comment ce sens automatique d’adaptation s’installe-t-il en habitudes d’action, de pensées et d’interprétations ?
Mieux connaitre mon fonctionnement, étudier les neurosciences et la Logique Émotionnelle m’aident à mieux comprendre et donc à agir plus en accord avec ma nature d’être humain, mon désir, mes besoins.
Par exemple, le jour où j’ai compris que mon cerveau était fait pour agir et non uniquement pour réfléchir, j’ai fait un grand pas sur le chemin d’un certain équilibre et d’une certaine sérénité. Effectivement, l’action me fait du bien, que cela soit marcher, jardiner, danser. Pour Nietzsche « les seules pensées valables viennent en marchant ! »
Plus largement, cette période met en évidence jusqu’où, au nom de son désir d’être toujours en sécurité, l’être humain s’adapte, voire, s’hyper-adapte ! Il est capable d’une vraie compassion et d’une profonde bienveillance, mais ses mécanismes défensifs, sous la forme de déni, de violence ou de renfermement ne sont jamais loin. C’est cela aussi que nous donne à voir la Logique Emotionnelle. Nous sommes sur une ligne de crête, et comme des funambules en haut de la montagne, nous ignorons comment se passera la descente. Oui, vraiment, drôle de rentrée !
Jocelyne Pringard