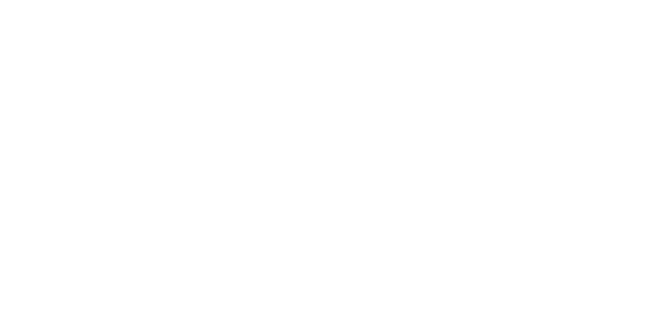Décidément, l’actualité Covid nous donne à voir combien nos automatismes et nos habitudes sont à l’œuvre en toutes circonstances. Chacun s’adapte au présent avec les polarités conservation-croissance. Certains des bien portants, au nom d’avoir toujours de la sûreté évitent les contacts, quand d’autres, au nom d’avoir toujours de la liberté entendent poursuivre leur vie comme d’habitude. Tout changement d’environnement nous interroge sur nos habitudes et révèle le processus émotionnel.
Survigilance, déni, révolte, dépression… telle est la façon défensive des uns et des autres de s’adapter au contexte présent. Que suis-je si… Qui suis-je si… Quel sens a ma vie si… ?
Ce Clin d’œil sera plus long que d’ordinaire puisque nous avons opté de faire paraitre un morceau choisi du témoignage préparé pour ce clin d’oeil par Usha, psychopraticien en Logique Emotionnelle qui a fait l’épreuve de la maladie COVID-19 et du coma artificiel. Nous verrons combien c’est tout le corps-esprit qui se mobilise dans une épreuve ultime. Alors qu’il constate ses stratégies de contrôle et de maitrise, il réalise aussi que ses habitudes de penser selon ce modèle entretient l’angoisse, puis comment en s’appuyant sur ses sensations, au présent, jusqu’à lâcher prise sur le contrôle, il prend prise sur le sens de la vie. Il abandonne sans s’abandonner, il choisit de suivre le mouvement de vie plutôt que lutter contre la mort.
Réanimons-nous !
Le 3 novembre 2020, à 14h37, j’ai l’impression de renaître. J’ai 45 ans. J’ai passé l’épreuve du Covid, après avoir été plongé dans un coma artificiel, appareillé, pour respirer sans épuiser mon corps.
Ce jour-là je me représente comme le personnage et l’auteur d’un film d’anima-tion au ralenti, chaque geste que je fais, autonome, est un cadeau. Ce « présent » je le palpe, je sens sa texture : épaisse, légère, rugueuse. Je respire à nouveau, seul. Je parle avec ma bien-aimée. Je bois de l’eau. Revivre d’air pur, d’amour et d’eau fraiche : la joie d’une re-découverte !
Quelques jours plus tôt, j’ai été « réanimé », soigné par des femmes et des hommes, éprouvés, à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Je leur dis humblement merci…
… J’ai traversé ce ou ces chocs traumatiques, ayant été traversé par eux. Au lieu de m’y arrêter, je m’en suis fait présent. Mon corps a eu du mal à s’en remettre (trois mois d’épreuve) et je vois en même temps à quel point l’expérience de l’épreuve peut s’avérer bénéfique.
J’ai vu combien mes habitudes mentales de pensées automatiques et comportementales de contrôle, m’ont conduit à exiger, parallèlement à ce que je vivais dans mon corps, de conserver coûte que coûte la maitrise et combien cette habitude alimentait mon anxiété. J’en ai fait l’expérience en direct live.
Comme en position méta par rapport à moi-même, je me vois penser, de deux manières :
- Penser, mouliner, chercher à contrôler, alimente chez moi l’anxiété, la peur de ne plus pouvoir respirer.
- Et simultanément quand je me vois penser, je vois comment le corps lui-même parle et se parle. Cette stratégie cognitive est elle-même du biologique, de l’aspiration à exister !
Deux formes de « penser » qui me font voir mon monde intérieur comme dissocié : mon corps, mon monologue intérieur, et moi-même me regardant agir/penser ? C’est encore une représentation !
En quoi la logique émotionnelle me sert dans cette épreuve et dans l’expérience qui s’en suit ?
La logique émotionnelle je ne sais pas exactement comment ça marche dans les tréfonds de mes automatismes biologiques, mais je sais que ça sert à quelque chose !
Par moments pendant l’épreuve, j’ai pu faire attention à la vie biologique qui m’animait, de voir au ralenti mes mouvements émotionnels, par séquences, pendant que j’étais dans l’expérience. Et ce même si je n’avais pas conscience de toutes les étapes de ce processus !
La pratique de la logique émotionnelle a permis, par bribes, que mon anxiété s’apaise, que mon attention se raccroche à quelque chose de vivant, corporel, au lieu de continuer à croire que je pouvais gérer ma panique, mon émotion. En acceptant mon impuissance je me suis donné un espace vide, plein de puissance potentielle, un creuset d’espoir où mon corps a pu se consacrer à son processus d’auto-guérison.
Mettre en mots m’a aidé, pendant, et après le choc traumatique à sur-vivre, en me considérant davantage humain, parce que cherchant à parler vrai : c’est-à-dire parler de mon processus vital à l’œuvre.
Je me remercie d’avoir fait et de faire déjà tout ceci pour moi, aussi imparfait fut-ce.J’ai été réanimé aux deux sens du terme :
- mon corps s’est remis à fonctionner sans que j’en ai conscience.
- je me suis éveillé aux sens qu’avaient les processus biologiques qui me traversent, notamment la fonction de la pensée :
- toujours vouloir, penser, alimente ma peur ;
- et simultanément penser c’est aussi se panser, au sens de se guérir.
« Quand on pense avec un e on panse toujours avec un a, penser c’est toujours soigner, quand on pense on doit soigner »
Bernard Stiegler
Je suis responsable de ce que je panse (enfin on peut le penser…)
Dans cette épreuve, j’ai appris que je peux ajouter un choix, ici celui de « vibrer » : par ma propre voix fredonnante mon corps vibre, par l’émerveillement face à la beauté du monde qui m’entoure (les bons soins des soignants, le chant des oiseaux, l’eau, l’air pur) mon esprit se calme, par l’espoir de partages à venir avec ceux que j’aime mon corps s’émeut et s’évade, par l’acte de penser/écrire/me parler de ce que je vis intérieurement, je m’occupe de moi aussi.
Au-delà de la capacité qu’exerce déjà le corps de s’auto guérir, ce choix minuscule « de me faire vibrer » favorise le rassemblement de ce qui est épars en moi en un corps esprit, conscient de lui-même, dans sa douleur, dans sa vitalité.
J’estime avoir eu de la chance de vivre cette épreuve et d’y sur-vivre au sens de pouvoir la dire. Telle est la valeur biologique du langage.
Comment on réagit par rapport à l’environnement ?
Et puis, j’apprends aussi que par rapport aux autres, mon environnement, c’est facile de partir. C’est plus difficile de revenir. J’ai fait l’expérience de ma sensibilité au lien et à l’amour de mon entourage. Réanimé, revenant dans le monde « normal », je me suis senti plusieurs semaines sur une autre planète, mes préoccupations tellement basiques (respirer à nouveau « l’air de rien ») contrastaient avec les préoccupations des autres qui me semblaient éloignées. L’anxiété de ne pas pouvoir respirer a duré quelques semaines après la sortie d’hôpital.
Et petit à petit, confiant que mon corps était en train de se guérir, mon nombril m’a ennuyé. Petit à petit seulement. J’ai senti que c’était le moment de partager cette expérience, en écrivant, encore une fois pour mieux me ressaisir, et aussi dans l’espoir peut-être d’aider ne serait-ce qu’une personne à sur-vivre (au sens de retrouver le sens vital) à une autre épreuve, la sienne.
J’extrapole ! Et notre société, de quoi pourrait-t-elle avoir besoin quand l’asphyxie se présente ?
Tant que nous nous racontons que ça va être difficile, douloureux, mortel, ou que nous sommes dans l’incertitude, nous entretenons le stress, personnel et collectif, sans pour autant nous prémunir du risque, lequel ne dépend pas de nous. Tant que nous alimentons notre moulin à pensées, tant que nous anticipons, tant que nous focalisons sur le problème auquel notre corps a déjà répondu biologiquement (et continuera à répondre car c’est la fonction même de notre système nerveux) la peur grandit en nous.
Et si penser pouvait devenir panser ? Nous avons besoin de prendre la responsabilité de nous-même sans se laisser confiner dans un mode de pensée, cons damnés à penser sans résonner, à tourner en rond dans un monde soi-disant rationnel.
Parlons de ce que nous vivons, ré-animons nous, pansons le monde pour faire la différance (avec un a comme écrivait Derrida), c’est à dire à la fois différer un instant la réponse à mon besoin (et par là faire preuve d’humanité) et aussi différencier ce que je vis (je suis un corps et ses choix – ceux que je fais face à l’adversité) !
Usha Matisson
Pour lire l’intégralité de cet écrit, cliquer ici