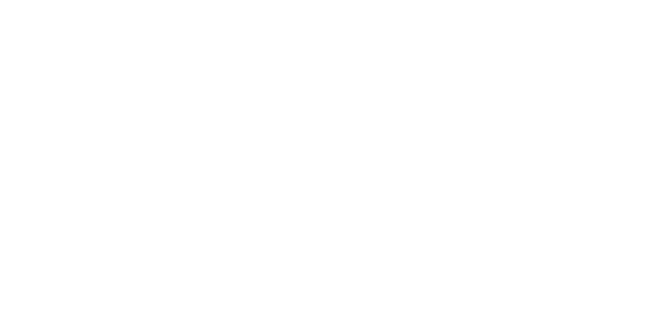« Et Nietzsche a pleuré… » de Irvin Yalom
Par Claude Guichet
Promo 3
Fiche de Lecture mars 2010
Ce roman relate l’histoire d’une rencontre qui aurait pu avoir lieu en 1882 entre le philosophe Friedrich Nietzsche affecté de nombreux maux (tête, estomac, cécité …) et le Dr Joseph Breuer, médecin praticien viennois connu et reconnu. Irvin Yalom s’est appuyé en effet sur une lettre retrouvée dans la correspondance de Nietzsche où la rencontre entre les deux hommes a été réellement envisagée par ses amis.
Cette rencontre imaginée par Irvin Yalom se déroule entre Octobre et Décembre 1882 à Vienne. Elle explore les relations entre les deux personnages et leur entourage à travers une succession d’entretiens, de lettres et d’évènements qui illustrent de manière vivante et romanesque les débuts de la psychothérapie, de la psychanalyse et pour ce qui concerne notre propos la relation Ecoutant-Ecouté et la bio-logique des émotions.
Notre grille de lecture étant la Logique Emotionnelle, je vous dirai ce qui a fait écho pour moi et ce que cet exercice m’a fait découvrir, ressentir.
Au préalable je vais vous resituer le texte dans le contexte avec une présentation succincte des deux principaux protagonistes et la trame de cette rencontre telle qu’imaginée par Irvin Yalom.
I – Les deux Personnages principaux
1-1 Le Docteur Joseph Breuer (1842 – 1925) : a donc 40 ans au moment où se situe l’histoire en 1882.
– juif non pratiquant, marié à une « belle » femme juive avec qui il a 3 enfants.
– médecin et praticien reconnu (aurait pu devenir Pdt de la Faculté de Médecine de Vienne). Il voit de plus en plus de gens souffrant de troubles psychiques.
– a suivi et traité les troubles d’hystérie d’une belle jeune femme (21 ans) dénommée Bertha.
– a des relations amicales avec le jeune médecin chercheur Sigmund Freud alors âgé de 26 ans et avec qui il publiera « Les Etudes sur l’Hystérie » en 1895.
1-2 Le Professeur Friedrich Nietzsche (1844-1900)
– ex-professeur de philologie de l’Université de Bâle.
– écrivain et philosophe pas connu à cette époque, a publié « Humain trop Humain » en 1878 et le « Le gai Savoir » début 1882. Il est en train de rédiger « Ainsi parlait Zarathoustra » qui sera publié en 1883.
– a de nombreux maux (tête, estomac, vue…) et ses fréquentes migraines l’ont conduit à arrêter l’enseignement. Il passe son temps à voyager pour trouver le climat qui lui convient dans le sud de l’Europe (n’aime pas le froid)
-sort d’une relation courte et tumultueuse avec une jeune femme « intelligente, d’une grande beauté » Lou Salomé, liée également à un autre philosophe Paul Rée.
Le nœud de l’histoire commune aux deux personnages est qu’ils sont « pris » dans une relation triangulaire ou« pythagoricienne » selon les mots de Nietzsche dans le roman :
Breuer finit par tomber amoureux de sa patiente Bertha et devient jaloux du jeune médecin qui a pris le relais du suivi de Bertha et qui tombe lui aussi amoureux de Bertha . Suite à la révélation « fantasmée » de Bertha comme quoi elle serait enceinte du Dr Breuer, la femme du Dr Breuer exige qu’il arrête immédiatement de suivre le cas de Bertha.
La rencontre de Nietzsche avec Lou Salomé à Rome remonte à avril 1882. Avec Paul Rée philosophe et ami de Nietzsche, ils parlent de former à 3 une micro-communauté intellectuelle. Nietzsche fait une proposition de mariage à Lou Salomé un mois plus tard, celle-ci refuse et c’est le début du désamour …
II – La Fiction de la Rencontre Nietzsche – Breuer.
Lou Salomé rencontre le Dr Breuer pour le convaincre de recevoir Nietzsche afin de l’observer, le soigner et l’empêcher de mettre fin à ses jours comme il lui écrit dans ses lettres.
Entretiens entre le Dr Breuer et Nietzsche et la relation Thérapeute/ Patient ou Ecoutant/ Ecouté s’inverse progressivement.
1/ au début du roman, Nietzsche refuse catégoriquement de se faire hospitaliser et de subir la relation de pouvoir du thérapeute.
2/ stratagème de Breuer :
Breuer soignera le corps de Nietzsche et Nietzsche soignera les troubles obsessionnels de Breuer / Bertha.
Breuer pense gagner ainsi la confiance de Nietzsche et le conduire à parler de sa relation avec Lou Salomé et de ses tentations suicidaires.
3/Progressivement Breuer ressent la profondeur de son désarroi, l’accepte et s’en remet à Nietzsche pour l’aider à en sortir
III – La lecture de ce livre et l’écho avec la LE, la relation Ecoutant/ Ecouté, l’écoute résonante.
Breuer a découvert une méthode qui semble guérir les troubles de Bertha en remontant aux causes premières des symptômes. En les retrouvant et en les exprimant les symptômes disparaissent …il s’agit « d’une cure par la parole » dénommée dans le livre « le ramonage ». Par exemple Bertha fait de l’hydrophobie, elle ne boit pas une goutte d’eau et le fait d’évoquer le souvenir d’un chien qui vient laper l’eau dans son écuelle, la phobie disparaît, au moins momentanément !
Nietzsche qui entend parler de cette méthode avec Breuer va l’utiliser à son tour pour explorer les troubles obsessionnels de Breuer.
Ce qui marche avec cette méthode de « cure par la parole » :
– quand Nietzsche reprend un mot de Breuer avec la forme interrogative (Ecoute Résonante) pour relancer l’écouté et le laisser développer …
– la philosophie de Nietzsche résonne avec la LE : la pensée procède du corps, ce n’est pas l’intelligence qui pense mais le corps ! Rupture avec l’idéalisme, l’ascétisme et le spiritualisme chrétien où seule l’idée est considérée comme pure. La conscience, l’esprit pensent sans relation avec une matérialité, avec le cerveau. Nietzsche veut le consentement au corps, l’amour de la Vie …
– le corps = Volonté de puissance : puissance d’exister par-delà le bien et le mal comme la plante ou l’arbre est attiré irrésistiblement par la lumière contourne /franchit les obstacles pierre, roche, bitume …
– en LE : la finalité de l’Etre c’est d’Etre !
Ce qui ne marche pas :
– quand Nietzsche développe, explique ses concepts philosophiques : se reconnaître comme simplement humain, s’accepter tel que l’on est ou encore « l’éternel retour » … Breuer entend, comprend le discours de Nietzsche mais cela ne l’aide pas, trop théorique, trop loin de ses Sensations/Perceptions à lui, ça ne lui parle pas, ça n’empêche pas ses troubles obsessionnels
Ce que j’ai intégré en lisant ce livre et qui illustre une des propositions du Ch 7 Le Funambule dans « Mon Corps le sait » de Catherine Aimelet-Périssol et Sylvie Alexandre.
* la personne est émue quand elle est partagée/ coupée dans la polarité de ses besoins
Sécurité : Breuer place le curseur du côté « Sureté », assurer les besoins de sa famille et de ses enfants, lui-même enfant « avenir tout tracé », « enfant infiniment prometteur », se réfugie dans le travail quand le reste ne va pas bien, va fleurir régulièrement la tombe de ses parents .Il s’accorde peu de Liberté par rapport à son avenir déjà tracé …
Identité : Breuer fait partie de la bourgeoisie juive médicale de Vienne qu’il critique « immuable », «pétri de conformisme » mais de laquelle il ne se démarque pas ostensiblement, se retrouve dans les mêmes cafés pour discuter, se détendre. Il porte les mêmes « habits noirs de médecin viennois », «sérieux » et « distant »
Réalité d’Etre : plus du côté Harmonie avec sa femme, sa famille, ses amis, il évite les sujets et discussions trop personnelles .Il ne se confie pas même avec Nietzsche car il y a cette interrogation est -ce que ce que je lui dis va le choquer ?
Il est donc coupé dans la Polarité de ses Besoins côté Liberté (les couleurs, la spontanéité…), Différence (se battre comme un guerrier, il refuse de la compétition avec les autres hommes par exemple avec Bertha il sait que son son statut de Médecin et sa connaissance des ressorts de Bertha font que aucun autre homme ne peut rivaliser avec lui pour Bertha), Initiatives (n’a rien fait pour devenir Pdt de la Faculté de Médecine).
Bertha est le miroir de ses manques et incarne à ses yeux ou lui renvoie l’image de la Liberté, la Différence et les Initiatives …
Face à cette Passion obsessionnelle pour Bertha que Breuer confie et explore « par la parole » avec Nietzsche, Irvin Yalom retrace en filigrane la relation passionnelle inverse dans les polarités et décrite comme « haineuse » que Nietzsche entretient avec Lou Salomé à travers ce qu’en dit Lou Salomé à Breuer et les lettres que Nietzsche envoie à Lou Salomé.
En effet le curseur des polarités chez Nietzsche est du côté de la Liberté (retraite qui lui permet voyages et itinérance), de la Différence (la solitude ne lui pèse pas, il ne recherche pas la compagnie…) et des Initiatives personnelles (la création, l’écriture de ses livres est son œuvre et sa Vie, il rédige à cette époque son œuvre majeure « Ainsi parlait Zarathoustra »).
Lou Salomé lui a fait percevoir ou révélé cette part qui lui manque (Sureté, Connivence intellectuelle forte …) et à laquelle il ne semble pouvoir accéder seul !
Conclusion : ce que ce livre m’a appris, ce qu’il a fait résonner chez moi …
J’ai goûté avec cet exercice la part de hasard, de tâtonnements dans la connaissance, la découverte de soi à soi, pour soi.
1/ être ouvert, faire le vide, accepter de ne pas savoir ou si peu par rapport à tout ce qui reste à connaître.
Et je pense au mouvement de l’algue ballottée par la mer, bougeant en surface au gré des mouvements des vagues ou encore à un autre mot « voir c’est recevoir passivement ». Accueillir l’événement, l’accepter tel qu’il est, ne pas vouloir le retenir, se l’approprier… faisant écho à une formule de Arnaud Desjardins «Intérieurement Activement Passif ».
2/ laisser résonner en Soi, sentir, se laisser toucher et être présent, ancré, enraciné face à l’événement … Et là je pense au « Bambou » droit comme une antenne qui capte les ondes et les transmet à l’écran du téléviseur qui reçoit les informations, les images mais sans réagir … ou encore cette autre formule de Arnaud Desjardins « Extérieurement Passivement Actif »
Et c’est bien de ce dialogue Corps/Esprit que naît le mouvement fluide, l’idée juste pour Soi, faite d’intuition, d’élan ou d’instinct.
Cette distance, ce recul par rapport au livre de Irvin Yalom et la résonance qu’il a suscité, s’est manifestée par hasard avec l’écoute de l’opéra « Carmen ».C’est un de mes opéras préférés que j’essaie de faire découvrir à mes garçons .En réécoutant le CD dans la voiture la semaine précédant le stage LE de mars, j’ai saisi tout à coup que le nœud de l’histoire de l’Opéra de Carmen avait aussi quelque chose à voir avec cette relation « pythagoricienne » ou triangulaire ( Carmen la Zingara / Don José le soldat / Escamillo le Torréador) et que l’intensité de l’émotion ressentie , la passion vécue jusqu’au drame, renvoie aussi à cette coupure dans les polarités des besoins telle que le dit la Logique Émotionnelle :
Carmen : La Liberté (ce mot revient comme un leitmotiv dans les différents airs), la Différence, les Initiatives (les amours de Carmen ne durent pas plus de 6 mois)
Don José : le soldat loyal, fidèle, qui répond au son du clairon, appartient à un régiment et dont la première qualité attendue d’un brigadier est l’obéissance …
Et Carmen va chambouler complètement ses repères et le conduire au drame, à la tragédie !
Et là j’ai compris, j’ai vu en entendant cet Opéra ce qui me touchait dans cette musique, ses pulsations, son rythme, le souffle, le timbre des voix, les sons et les images des paroles, le tourbillon, le vertige de l’émotion quand l’individu est coupé, partagé. La LE trouvait là, à cet instant, une application évidente que je sentais et offrait une lecture inattendue de ces relations pythagoriciennes découvertes l’une à travers la lecture du livre de Yalom et l’autre avec l’Opéra de Carmen. La Logique Émotionnelle prenait un tour plus passionnel, entier, immédiat, instinctif touchant à ce qu’il y a de plus humain, de plus profondément humain qui pouvait conduire à des comportements diamétralement opposés :
– la joie, l’enthousiasme (traduction du mot grec « folie divine ») quand les polarités sont unifiées
– la folie humaine quand les polarités sont irrémédiablement coupées chez l’individu avec son lot de névroses /psychoses plus ou moins morbides/mortifères pouvant conduire jusqu’à … la lutte à l’arme blanche entre les deux rivaux et la fin tragique, le désespoir de Don José et la mort de Carmen.
Et de revenir à ma mémoire ce symbole du « bivium pythagoricien » y découvert par hasard il y a trois ans, sur fond de tapisseries de l’Apocalypse du Château d’Angers en même temps que d’autres symboles et événements dont la synchronicité m’était apparue de façon tout à fait inattendue .Et le sens donné à ce symbole y dans une brochure « le carrefour de la vie , symbole du choix entre vie et mort , vertu et vice » .
Et je n’étais pas arrivé au bout de mes associations et découvertes : j’avais entendu en effet à une émission de radio du dimanche matin « Maison d’Etudes » avec comme invité Marc-Alain Ouaknin qui expliquait que le y renvoie dans l’alphabet hébreu à « AYN » qui désigne l’œil,la source , la lumière avec deux sens ou deux mouvements distincts :
– la vision globale, large et intuitive « je vois et je comprends » (est dit « sage » celui qui voit l’avenir)
– et « je veille », je suis vigilant, l’attention, le regard sont plus précis.
Dans le livre de Marc-Alain Ouaknin « Les Mystères de l’Alphabet », il apparaît que ce symbole pythagoricien de la tapisserie d’Angers ressemble bien à la forme graphique classique (écriture carrée) du mot hébraïque « AYN » ou « OYN » qui a donné la lettre O de l’alphabet hébreu (et non pas la lettre de l’alphabet Y comme je vous l’ai dit dans mon exposé). Il est précisé en outre que ce « AYN » énonce tout ce qui est de l’ordre du visible, du Voir, du regard, de l’apparition. Mais qui dit apparaître dit aussi cacher, recouvrir. Ainsi le « AYIN »est le passage entre l’intérieur et l’extérieur, entre les profondeurs cachées et ténébreuses de la Terre et la clarté du monde solaire .Le « AYIN » c’est la source (le jaillissement) le point de passage de l’eau souterraine à l’eau qui coule à la lumière .C’est le point où l’être se dévoile mais en même temps se voile …Avec le « AYIN » le monde devient pluriel, multiple, découvert, secret.
Et d’entendre encore dans cette même émission radio que la lettre « O » est suivie par la lettre « P » dont la forme originaire représente la bouche et d’en déduire « Si on voit, on peut parler … » …et de lire toujours chez Ouaknin que dans « AYIN » il y a une seconde dialectique celle du voir et de l’entendre. « Chemà », « écoute » s’écrit « cham-ayin » « là-bas l’oeil » .Entendre est une façon de voir plus loin, au-delà de la simple apparition qui se fait dans la proximité.
Et là, retour direct au Ch 7 Le Funambule page 140 de « Mon corps le sait », « VOIR ou REGARDER, ENTENDRE ou ECOUTER. »
« L’émotion vient fixer la vision ou l’ouïe sur l’une ou l’autre de ces facultés, comme si les possibilités de mobiliser l’ensemble étaient perturbées, bloquées. Ce clivage en soi prive de l’information globale. Pas étonnant que la personne prenne pour elle ou contre elle ce qu’elle voit ou ce qu’elle entend. ».